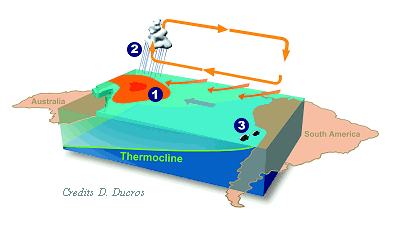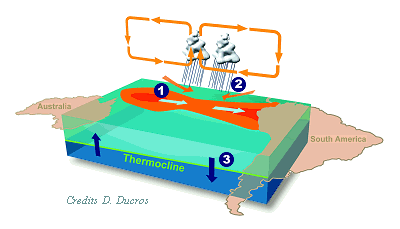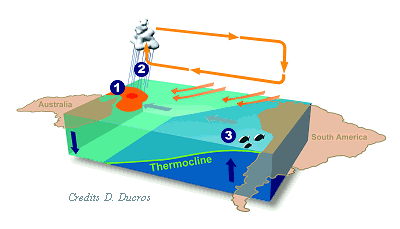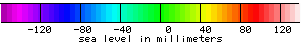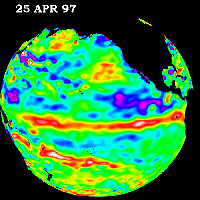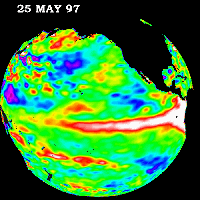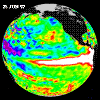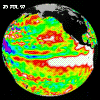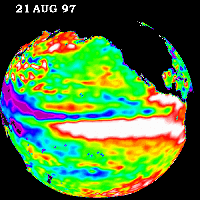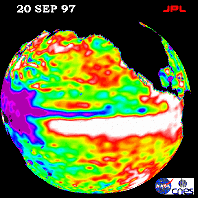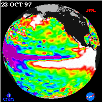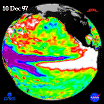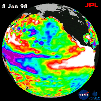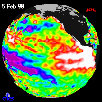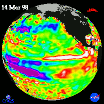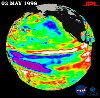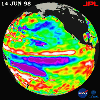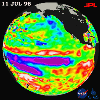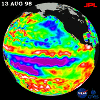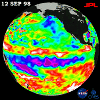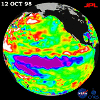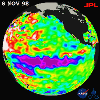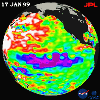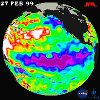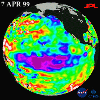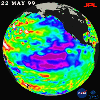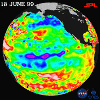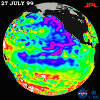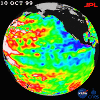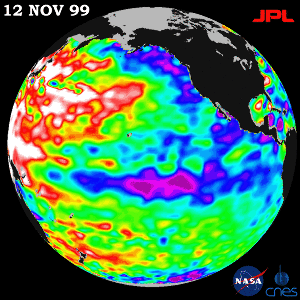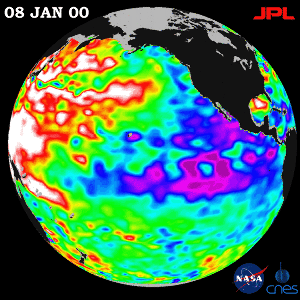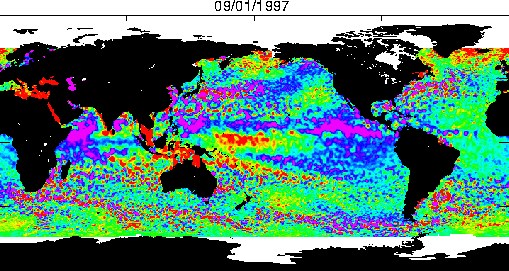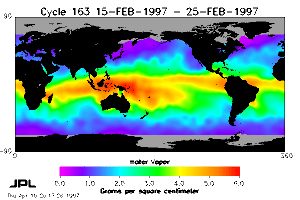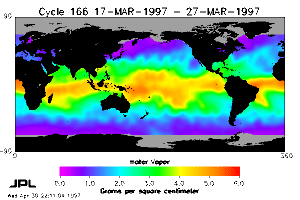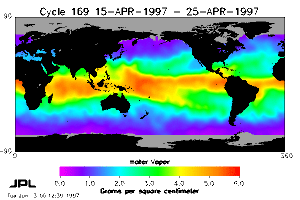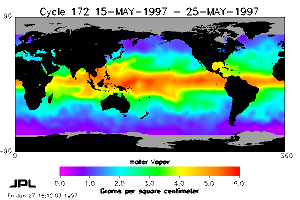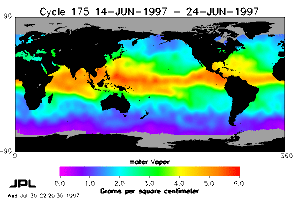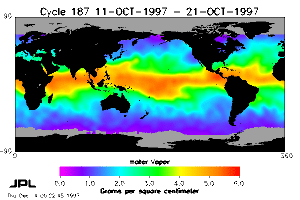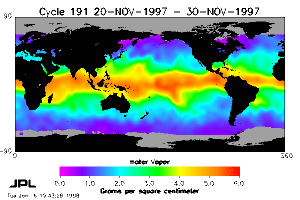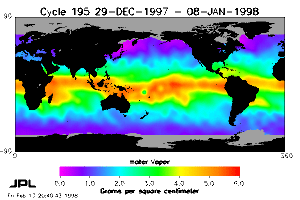El Nin͂o / la Nin͂a 1997-2000
Article | 18/02/2000
Résumé
Explications et observation du phénomène climatique El Niño / La Niña.
Table des matières
Que sait-on sur El Niño ?
Vinca Rosmorduc, de "Collecte Localisation Satellite", Direction Océanographie Spatiale (CLS/DOS), vous propose de comprendre ce phénomène climatique à partir des schémas explicatifs disponibles sur le site AVISO.
Régime normal de l'océan Pacifique
Figure 1. Régime normal sur l'océan Pacifique
La surface de la mer est plus élevée à l'Ouest, en Asie, qu'à l'Est, le long des côtes Sud-américaines. La thermocline (frontière séparant les eaux chaudes de surface et les eaux froides profondes) est inclinée dans le sens opposé (plus haute à lEest).
Régime El Niño
Figure 2. Régime El Niño sur l'océan Pacifique
Les pentes de la surface de la mer et de la thermocline se redressent pour se rapprocher de l'horizontale.
Régime La Niña
Figure 3. Régime La Niña sur l'océan Pacifique
La surface de la mer est encore plus élevée à l'Ouest qu'à l'Est. La pente de la thermocline s'accentue aussi, s'enfonçant à l'Ouest et se relevant encore plus à l'Est.
Images des anomalies de surface océanique (SSA) : El Niño/La Niña - 1997 à 2000
Les images ci-dessous proviennent du site du Jet Propulsion Laboratory (JPL). Elles montrent comment se font les déplacements des eaux chaudes de surface dans le Pacifique tropical.
Figure 4. Légende des cartes TOPEX/Poséidon
Les couleurs cartographiques précisent le niveau moyen relatif de l'océan (par exemple, la couleur blanche indique une hauteur d'eau de plus de 125 mm au-dessus de la valeur de référence).
Les couleurs précisent indirectement la température de l'eau de surface. Sous l'effet d'une augmentation de température, le niveau moyen de l'océan augmente par expansion thermique. Ainsi la couleur blanche représente également une eau de surface plus chaude que la normale, de 4 à 6°C. Notez que, un peu comme dans le cas des icebergs, pour une hausse du niveau de l'océan de 1 cm au-dessus du niveau de référence, l'épaisseur d'eau chaude sous le niveau de référence est de 200 cm. Il y a abaissement de la thermocline (interface entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides profondes) de 2 m.
Mars 1997. Les vents d'Est (alizés) se relâchent, ce qui déclenche une onde océanique qui parcourt l'océan d'Ouest en Est. Les eaux chaudes de surface (couleur rouge et blanche) se déplacent alors depuis la source, au Nord-Est de l'Australie, vers l'Est, en direction des côtes de l'Amérique du Sud. C'est le phénomène El-Nin͂o.
Figure 5. Avril 1997 Les eaux chaudes El Nin͂o (rouge et blanc) atteignent les côtes américaines. | Figure 6. Mai 1997 Les eaux chaudes (en rouge et blanc, plus haute de 125 mm par rapport au niveau moyen et plus chaude de 4 à 6°C) s'étalent le long de la côte américaine. | Figure 7. Juin 1997 L'étalement des eaux de surface plus hautes que la normale et donc plus chaudes se poursuit vers le Nord et le Sud de la côte américaine. Les pêcheurs péruviens commencent à ressentir les effets de cette arrivée d'eau chaude qui perturbe la remontée des eaux profondes (upwelling) plus froides et riches en nutriments nécessaires à l'écosystème marin. |
Figure 8. Juillet 1997 L'étalement des eaux chaudes se fait sur une surface équivalente à une fois et demi la surface des États-Unis. Le volume de ces eaux chaudes correspond à 30 fois celui de tous les Grands Lacs réunis. L'excès de chaleur apporté par ces eaux correspond à 90 fois l'énergie des combustibles fossiles utilisées pendant une année entière par les États-Unis. | Figure 9. Août 1997 Près de l'Australie, des bandes violettes (plus de 125 mm au-dessous du niveau moyen de l'océan) grossissent de plus en plus. Les températures de l'océan dans cette région sont anormalement basses. Dans ces conditions, l'océan échange moins d'humidité et d'énergie avec l'atmosphère, ce qui génère des conditions de sécheresse en Australie et en Indonésie. | Figure 10. Septembre 1997 La répartition de la zone d'eau chaude (plus de 5°C au dessus de la normale) se stabilise dans le Pacifique tropical. Près de l'Australie, les bandes violettes se rassemblent dans le Pacifique Ouest. Les températures y sont anormalement basses. |
Figure 11. Octobre 1997 Les eaux chaudes d' El Nin͂o progressent vers l'Alaska. Au Nord de la bande équatoriale d'eau chaude, le niveau de la mer continue à baisser par rapport à la normale (zone violette). Cette topographie océanique augmente alors le courant Nord équatorial, NECC. L'augmentation du niveau de l'océan le long des côtes américaines est ainsi amplifiée. | Figure 12. Novembre 1997 La surface couverte par les eaux chaudes augmente sensiblement, surtout le long de la côte Ouest des États-Unis. Le niveau de l'océan s'élève alors à 40 cm au-dessus de la moyenne dans le Pacifique est, près des îles Galapagos. La thermocline (interface entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides profondes) s'abaissent de 8.000 cm (80 m) environ. El Nin͂o continue à aggraver les conditions climatiques globales, les températures élevées de la surface océanique influençant directement l'atmosphère. | Figure 13. Décembre 1997 Les océanographes constatent que El Nin͂o est associé une variation rythmique de la surface des eaux chaudes, en relation avec la rythmicité des vents du Pacifique central et Ouest. |
Figure 14. Janvier 1998 Le volume des eaux chaudes El Nin͂o a diminué de 40% par rapport à son maximum de novembre 1997. La surface couverte par la zone d'eaux chaudes est encore égale à 1,5 fois la surface des États-Unis. | Figure 15. Février 1998 Le volume et la surface des eaux chaudes restent importants, mais la bande s'est épaissie au niveau de l'équateur et de la côte d'Amérique du Sud. | Figure 16. Mars 1998 La quantité d'eaux chaudes a sensiblement diminué. Dans le Pacifique central, les eaux sont revenues à leur niveau moyen. Les eaux chaudes se répartissent alors au Nord et au Sud de l'équateur. Les océanographes indiquent que c'est la situation classique qui annonce un retour progressif des conditions océaniques vers la normale. |
Figure 17. Mai 1998 Le retour aux conditions de hauteurs océaniques normales se poursuit. Le Pacifique Ouest est toujours dans des conditions d'eaux plus froides que la moyenne (bandes violettes), en relation avec le déclin du phénomène El Nin͂o. | Figure 18. Juin 1998 Au Nord de l'équateur, on constate un reste de la bande d'eaux chaudes El Nin͂o. La large bande violette d'eaux superficielles froides est surveillée par les scientifiques pour voir si elle n'est pas en relation avec le phénomène climatique La Nin͂a. Cette situation climatique inverse d'El Nin͂o correspond à la présence d'eaux superficielles froides dans le Pacifique tropical. | Figure 19. Juillet 1998 Le déclin d' El Nin͂o se poursuit. |
Figure 20. Août 1998 Les masses d'eaux superficielles froides ne bougent presque pas. Quelques restes d' El Nin͂o sont encore visibles au Nord et au Sud de l'équateur. | Figure 21. Septembre 1998 Le refroidissement de l'océan Pacifique central se ralentit et la surface des eaux de bas niveau décroît progressivement. Cette situation va perdurer et continuer à influencer les conditions climatiques mondiales pendant l'automne et l'hiver 1998. | Figure 22. Octobre 1998 Pas de grands changements dans l'altimétrie de l'océan Pacifique depuis juillet 1998. Les conditions océanographiques La Nin͂a se confirment. |
Figure 23. Novembre 1998 idem. Les conditions de bas niveau océanique associées à La Nin͂a et la mise en place d'une large surface d'eaux chaudes dans le Pacifique Ouest montrent la coexistence de situations contrastées. | Figure 24. Janvier 1999 La bande des eaux froides le long de l'équateur (La Nin͂a) est moins épaisse. La Nin͂a continue à influencer le climat mondial. Pour les océanographes, les eaux froides agiraient en modifiant la course des tempêtes qui prennent naissance au dessus de l'Océan, en ralentissant les courants océaniques et en guidant les vents majeurs de la planète. | Figure 25. Février 1999 La Nin͂a domine toujours, depuis le mois de mai 1998. À cause de son maintien dans l'Océan Pacifique, les scientifiques pensent que La Nin͂a influencera les systèmes climatiques durant le printemps et l'été 1999. Sur cette image, on remarque la présence d'une large zone d'eau élevée et chaude dans le Pacifique Ouest, depuis les tropiques jusqu'au golfe d'Alaska. L'apparition de ces eaux chaudes n'est pas bien comprise mais elles influencent le climat de la planète. |
Figure 26. Avril 1999 Le phénomène La Nin͂a commence à s'atténuer, même si les conditions océaniques ne sont pas revenues à la normale. Dans le Nord et le Sud du Pacifique, le niveau de l'océan reste élevé et ce depuis plusieurs mois. La distribution thermique de l'Océan Pacifique est encore fortement perturbée. | Figure 27. Mai 1999 Les côtes de l'Amérique du Nord sont touchées par les eaux anormalement froides du Pacifique. Le climat régional devrait être influencé durant l'été. La surface océanique refroidie et associée à La Nin͂a dans la zone équatoriale se fragmente en plusieurs bandes. | Figure 28. Juin 1999 La Nin͂a semble disparaître. L'océan Pacifique revient à sa situation normale (couleur verte). Le réchauffement de l'Océan Pacifique est sensible dans la zone équatoriale. Les scientifiques attendent les données altimétriques de l'été 1999 pour déterminer si La Nin͂a a vraiment disparu ou s'il y aura une autre résurgence d'eau froide dans le Pacifique. |
Figure 29. Juillet 1999 Le Pacifique Nord continue d'osciller entre chaud et froid : le Nord-Est montre des eaux anormalement basses et froides alors que le Nord-Ouest révèle la présence d'eaux élevées et chaudes. Cette situation persiste pendant quatre mois, influençant le climat du Nord de l'Amérique. | Figure 30. Octobre 1999 TOPEX/Poséidon détecte dans l'Est du Pacifique Nord un abaissement anormal de la surface océanique et une élévation dans l'Ouest. | Figure 31. Novembre 1999 Dans l'Est du Pacifique Nord, la surface de l'eau est anormalement basse. Au contraire, dans l'Ouest et au centre du Pacifique, les masses d'eaux sont élevées. Ces conditions, à tendance La Nin͂a, devraient conduire à l'apparition de tempêtes dans le Nord-Ouest du Pacifique, laissant le Sud-Ouest des États-Unis dans des conditions de sécheresse. |
Figure 32. Janvier 2000 Les anomalies du niveau de l'océan constatées en novembre à l'Ouest du Pacifique se maintiennent. Un événement La Nin͂a se développe. |
Animation
Sur le site NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) , vous trouverez des animations des événements El-Nin͂o et La Nin͂a des années 1983 à 1999. Sur le site français AVISO, vous pourrez trouver une animation d'El Nin͂o 1997 créée à partir d'images gif des anomalies du niveau de la mer (entre le 26 février et le 5 novembre 1997) :
Images de la quantité de vapeur d'eau atmosphérique pendant l'année 1997
Les images (site JPL-NASA) transmises par le satellite Topex-Poseidon permettent de suivre la migration des masses d'air humides en relation avec le déplacement des masses d'eau d'Ouest en Est pendant l'évènement El Nin͂o 97-98. On peut imaginer observer une situation inverse lors de la Nin͂a consécutive.
Principe de la mesure de la quantité de vapeur d'eau atmosphérique
Topex/Poséidon mesure la hauteur de l'océan en estimant le temps d'aller-retour d'une onde (générée par un altimètre radar) entre le satellite et la surface de l'océan. La vapeur d'eau atmosphérique diminue le temps de parcours de l'impulsion et, de ce fait, introduit une erreur dans l'estimation de la hauteur de la surface océanique. Pour réaliser les corrections nécessaires, un radiomètre satellitaire mesure la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, entre le satellite et la surface de l'océan. La mesure s'effectue en g/cm2 et la correction de la hauteur de l'océan est alors calculée en cm. Sans cette correction, 5 g/cm2 de vapeur d'eau génèrent une erreur de mesure altimétrique de 32 cm !
Les images
Figure 33. 15/02/97 - 25/02/97 | Figure 34. 17/03/97 - 27/03/97 | Figure 35. 15/04/97 - 25/04/97 |
Figure 36. 15/05/97 - 25/05/97 | Figure 37. 14/06/97 - 24/06/97 | Figure 38. 11/10/97 - 21/10/97 |
Figure 39. 20/11/97 - 30/11/97 | Figure 40. 29/12/97 - 08/01/98 |
Les fortes concentrations en vapeurs d'eau sont indiquées en rouge ; elles correspondent aux régions tropicales au-dessus des océans Pacifique et Indien, là où les eaux de surface sont les plus chaudes. Les concentrations les plus faibles sont indiquées en violet ; elles correspondent aux régions polaires, là où l'air est froid et sec.
Le couplage océan-atmosphère : la place de la vapeur d'eau
La vapeur d'eau atmosphérique joue un rôle important dans la circulation atmosphérique. Lors de sa condensation, la chaleur libérée constitue un moteur de la circulation atmosphérique. La quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère est liée à l'humidité à la surface de l'océan. Cette humidité contrôle les transferts de chaleur de l'océan vers l'atmosphère au cours du phénomène d'évaporation.
Par ailleurs, la vapeur d'eau atmosphérique est le principal gaz à effet de serre : il intervient dans l'équilibre radiatif de la Terre, en absorbant le rayonnement infrarouge tellurique. Estimer la quantité globale de vapeur d'eau est donc une étape importante dans la compréhension du rôle des océans dans l'évolution du climat.